15
avr.
2011
J'ai écrit avec quelques camarades du groupe Traces un livre collectif intitulé Les scientifiques jouent-ils aux dés ?, à paraître aux éditions du Cavalier Bleu dans la collection "Idées reçues Grand angle". Son principe : analyser nombre d’idées reçues sur la science et sur ceux qui la font, en mobilisant les travaux de l'histoire, sociologie et philosophie des sciences. L'ouvrage a été dirigé par Bastien Lelu et Richard-Emmanuel Eastes, et préfacé par Dominique Pestre. Mélodie a déjà publié son texte sur la vulgarisation, voici le mien sur l'expertise (version de l'auteur, différente de la version finalement publiée).
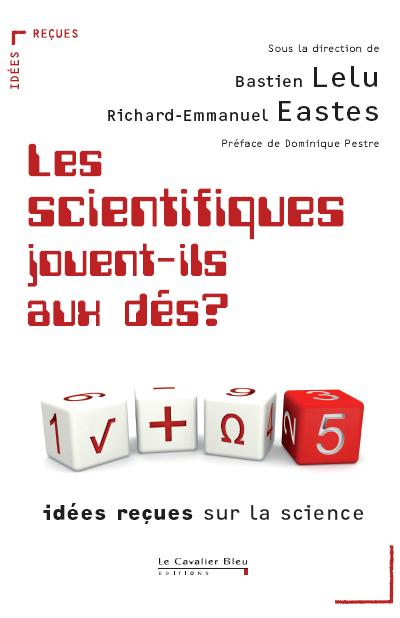
L'expertise, qu'est-ce c'est ?
L'expert, c'est d'abord le spécialiste, comme les héros de cette série télévisée qui se livrent à des reconstitutions de scènes de crime ou à l'identification d'empreintes ADN. Équipés de leurs outils, armés de connaissances bien maîtrisées, ils sont capables de donner du sens à des éléments d'information épars et incomplets. Une flaque de sang, un lambeau de tissu sous un ongle… Leur théâtre d'action est surtout mécanique, parfois aseptisé, offrant des conditions de travail très proches de celles du laboratoire et permettant de mettre naturellement en application un savoir scientifique et technique.
Mais il y a une autre figure de l'expert. Dans la presse, face à un tribunal ou lors d'une audition parlementaire, l'expert est un spécialiste qui doit sortir de son champ d'action contrôlé et mettre son savoir en situation. Il n'est plus simplement chargé d'objectiver ou de quantifier, et on lui demande de préciser d'où il parle, de fournir des arguments avec un degré de confiance qui peut être inférieur à 100% et d'avancer des recommandations. Ce qui compte alors, c'est non seulement la science froide et solide, mais aussi les théories en émergence, la culture des communautés scientifiques, leurs présupposés. On raconte ainsi que quand Al Gore était vice-président des États-Unis, il demandait à chaque expert qu'il auditionnait : "Quelles sont vos hypothèses ?" Car il savait bien que chaque théorie ou explication avancée par la science repose sur des hypothèses, et que la conclusion ne vaut rien si on ne sait pas quelles sont ces hypothèses de départ ou implicites du raisonnement. Quand un biologiste explique qu'un maïs OGM est équivalent en substance au même maïs non OGM, c'est que pour lui la transgenèse découle des techniques précédentes de sélection variétale et ne constitue pas une rupture conceptuelle ou technique.
Lorsque la parole de l'expert devient publique et sert de passerelle entre science et décision, c'est de sa responsabilité de rendre cet échaufaudage intellectuel visible, et de celle des autorités de mettre en œuvre une expertise contradictoire qui confronte les points de vue et ose faire ressortir les divergences. En ce qui concerne les OGM par exemple, il a été montré que les généticiens n'ont globalement pas les mêmes positions que les écologues ou les agronomes. Et surtout, ils ne basent pas leurs positions sur les mêmes arguments et considérations, ce qui force à prendre de la distance ou au moins à remettre en perspective l'éclairage des experts.
Sinon, les conséquences peuvent être graves. L'expert ne se contente pas de donner un avis mais conduit à ériger des normes, les hiérarchiser, et contribue ainsi à énoncer de nouvelles règles de comportement qui structurent le monde où nous vivons — qu'il s'agisse d'autoriser des aliments nouveaux, d'encadrer les nouvelles pratiques de procréation médicalement assistée ou de réguler le commerce international.
Faut-il avoir confiance dans l'expertise ?
L'expertise scientifique sert souvent à éclairer l'action politique. Qu'elle soit le fait d'un corps constitué, comme l'Académie des sciences dont c'est l'une des missions, ou d'individus volontaires, elle permet de mettre les savoirs techniques au service de la société. Cependant, il arrive aux décideurs de faire appel aux experts pour recouvrir leurs décisions d'un vernis d'objectivité (au lieu d'assumer les valeurs qui les justifient) ou se dédouaner de leur responsabilité en cas d'impopularité ou d'échec. Les chercheurs continuent cependant à se porter caution parce qu'ils y trouvent leur intérêt, justifiant ainsi les investissements consacrés à la recherche scientifique et se prévalant du rôle de "conseiller du prince" considéré comme privilégié. Ce petit jeu peut être risqué : en entretenant leur "privilège d'extra-territorialité politique" (comme l'appelle Jean-Marc Lévy-Leblond), les chercheurs veulent échapper à la juste règle commune et peuvent se retrouver pris au piège entre une fausse autonomie et un effilochement des alliances avec le corps social. C'est-à-dire qu'à vouloir imposer à tous leur rève d'un savoir objectif et positif, à la fois utile pour eux et l'humanité entière, ils se retrouvent vidés du sens premier de leur mission et du soutien collectif.
C'est une des raisons pour lesquelles les institutions ou laboratoires de recherche ne doivent pas perdre de vue l'environnement dans lequel elles avancent et ce qui leur permet de tenir une position d'expertise indépendante et impartiale. Jusqu'à l'émergence du débat public sur les OGM, l'Institut national de la recherche agronomique (Inra) se positionnait comme un fer de lance de l'innovation variétale, obtenant de nouvelles variétés destinées aux agriculteurs français, y compris transgéniques. Il s'apprêtait vers 1995-1996 à mettre sur le marché un colza génétiquement modifié, tolérant à un herbicide, co-développé avec des sociétés semencières privées. Mais la direction de l'Inra fit volte-face en 1997-1998, pour ne pas perdre sa légitimité à intervenir ensuite comme expert dans l'espace public. Cette barrière que l'Inra décida de ne pas franchir n'est pas toujours identifiable facilement. Les experts d'un domaine se retrouvent parfois à conseiller des entreprises privées et à siéger dans des comités d'homologation, sans y voir forcément de conflit d'intérêt… et en profitant même de ces diverses activités pour enrichir leur expertise !
C'est pourquoi on fonde de plus en plus la légitimité de l'expertise non plus sur la légitimité de la science mais sur des procédures contrôlables. Ces procédures ont déjà été évoquées : expertise collective et non individuelle, contradictoire plutôt qu'appuyée sur les seules positions qui font consensus, mentionnant les avis minoritaires, transparente et indépendante. Au lieu de contenir l'incertitude et de chercher à la réduire, il s'agit de la cerner et la rendre visible. Et tenter de cadrer le moins possible les experts : si le Comité permanent amiante (1982-1995) n'a pas permis de faire émerger le risque de ce matériau pour la santé publique et d'en interdire l'usage, c'est parce qu'il était pris dans un dispositif qui lui laissait comme seule possibilité d'intervention le contrôle de l'exposition professionnelle.
Les nouvelles tendances de l'expertise
L'expertise scientifique a longtemps été le fait de chercheurs engagés. Mais depuis la fin des années 1970, on assiste à une transformation des mobilisations des chercheurs, qui ne se reconnaissent plus dans l'image du communiste Frédéric Joliot-Curie ou du "chercheur responsable" qui politise son champ de compétence. À la place, on voit émerger la figure du "lanceur d'alerte" sanitaire ou environnementale, plus rare, individuel et moins directement en porte-à-faux avec l'institution. Les collectifs de chercheurs engagés, porteurs d'une contre-expertise comme dans les domaines du nucléaire ou de la santé, ont quasiment disparu au profit des organisations de la société civile (associations de malades, de solidarité, écologistes…). Ce mouvement est à la croisée de quatre tendances complémentaires, amenées à se développer :
- face à des enjeux de plus en plus globaux et complexes (comme le climat ou la biodiversité), l’expertise scientifique participe souvent davantage à l’extension de la controverse et à la polarisation des débats qu’elle ne permet d’en sortir ; plutôt que d'attendre la preuve scientifique formelle, on en vient à privilégier une attitude comme celle du principe de précaution, qui fait valoir que l’absence de preuves ne saurait empêcher l’adoption de mesures destinées à prévenir un dommage. La trajectoire entre le laboratoire et l'expertise devient moins linéaire, remplacée par un processus d'apprentissage collectif au fur et à mesure que les certitudes évoluent ;
- le corps social dans son ensemble profite de cette recherche en plein air. Au moment même où le niveau de scolarisation progresse, le credo du progrès est mis à distance et l'État décline, les frontières entre professionnels des institutions scientifiques et autres acteurs (usagers, malades, publics, praticiens, militants…) ne peuvent que devenir poreuses, impulsant une société de la connaissance disséminée :
- les savoirs et engagements profanes sont reconnus pour leur légitimité et leur utilité, venant compléter les savoirs scientifiques experts. Cette combinaison a fait ses preuves dans de nombreux cas, des bergers anglais dont l'expérience locale peut être plus opératoire que des savoirs scientifiques plaqués abruptement aux malades du sida intervenant dans la conception de nouveaux essais thérapeutiques ;
- les citoyens et groupes concernés s'impliquent de plus en plus dans les décisions, approfondissant ainsi la démocratie délégative par une démocratie dialogique avec une multiplication des espaces de débats et de choix (démocratie technique participative, conférences de citoyens…).
Bibliographie :
JacquelineJanine Barbot (2002), Les Malades en mouvements : la médecine et la science à l’épreuve du sida, Paris : Balland- Christophe Bonneuil (2005), "Les transformations des rapports entre sciences et société en France depuis la Seconde Guerre mondiale : un essai de synthèse", in Joëlle Le Marec et Igor Babou (dir.), Actes du colloque Sciences, Médias et Société, École normale supérieure Lettres et sciences humaines, Lyon 15-17 juin 2004, p. 15-40
- Christophe Bonneuil (2006), "Cultures épistémiques et engagement des chercheurs dans la controverse OGM", Natures Sciences Sociétés, vol. 14, pp. 257-268
- Christophe Bonneuil et Frédéric Thomas (2008), "L'Inra dans les transformations des régimes de production des savoirs en génétique végétale", in Christophe Bonneuil, Gilles Denis et Jean-Luc Mayaud (dir.), Sciences, chercheurs et agriculture, Paris : L'Harmattan/Éditions Quæ, pp. 113-135
- Michel Callon, Pierre Lascoumes et Yannick Barthe (2001), Agir dans un monde incertain. Essai sur la démocratie technique, Paris : Seuil
- Emmanuel Henry, "Militer pour le statu quo. Le Comité permanent amiante ou l'imposition réussie d'un consensus", Politix, n° 70, pp. 29-50
- Pierre-Benoît Joly (1999), "Besoin d'expertise et quête d'une légitimité nouvelle : quelles procédures pour réguler l'expertise scientifique ?", Revue française des affaires sociales, vol. 53, pp. 45-53
- Jean-Marc Lévy-Leblond (1996), La Pierre de touche, Paris : Gallimard Folio essais
- Naomi Oreskes (2004), "Science and public policy: what's proof got to do with it?", Environmental Science & Policy, vol. 7, pp. 369-383
- Philippe Roqueplo (1996), Entre savoir et décision, l'expertise scientifique, Paris : INRA Éditions
- Alexis Roy (2002), Les experts face au risque: le cas des plantes transgéniques, Paris : Presses universitaires de France
- Brian Wynne (1992), "Misunderstood misunderstanding: Social identities and public uptake of science", Public Understanding of Science, vol. 1, pp. 281-304


Derniers commentaires