Coordonné par deux chercheuses en biologie et microbiologie mais co-écrit avec cinq autres, ce petit livre paru fin 2013 s’inscrit dans la collection “Enjeux et débats” de l’association Espaces Marx et des Éditions du Croquant. Il synthétise des années de débat et d’analyse au sein d’Espaces Marx (en lien avec d’autres mobilisations) visant à replacer les difficultés de la recherche publique à la fois dans le cadre d’un capitalisme financiarisé en mal d’innovation et dans celui du déficit démocratique marquant les relations entre la science et la société
(p. 13). On sent les auteurs passionnés par ces questions, convoquant tour à tour des travaux académiques de philosophie des sciences ou des ouvrages plus « grand public », le programme de certains partis politiques ou les conclusions d’un Conseil européen récent.
Les auteurs structurent leur ouvrage de façon thématique, avec quatre parties encadrées d’une introduction et d’une conclusion. Je vais essayer ici de rendre compte plutôt de la progression logique de leur argumentation.
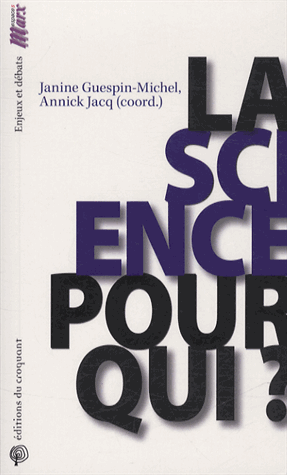
La première partie du livre s’attache à un état des lieux de la recherche française et occidentale. Revenant au tiraillement historique des sciences entre une autonomie nécessaire et une dépendance à l’égard des financeurs et des attentes de la société, ils traitent d’abord de cette question délicate de l’autonomie : la revendication du retour à l’autonomie imprègne une partie de la communauté scientifique
(p. 20). Elle trouve des relais dans les mouvements de chercheurs comme “Sauvons la recherche”, qui s’opposent aux normes externes de rentabilité et d’efficacité imposées par le “nouveau management public”
(p. 22). Mais comment faire abstraction de l’intrication très forte entre sciences et technique (à visée économique) ?
Les auteurs nous amènent alors à étudier les rapports entre sciences et technique. La technique, écrivent-ils, est consubstantielle à l’humanité en ce qu’elle est partout présente dans nos actes quotidiens, tout ce qu’on sait faire, ce qu’ont transfère à des outils, et le rapport qu’on établit avec eux (p. 23) — au-delà même des activités de production. Vers 1820, les grandes écoles d’ingénieurs ont développé le concept des sciences appliquées pour désigner les techniques mises en œuvre dans l’industrie naissante
(p. 25). C’est là qu’est née l’idée de techniques de productions rationnelles — comme directement issues des sciences —, devenue un des thèmes centraux du libéralisme puis de l’esprit républicain
. Aujourd’hui, le terme de « technologie », plus noble, a remplacé chez les élites celui de « technique », d’où sont exclues les sciences humaines et sociales. Et dans la guerre économique mondiale, la technologie est devenue la base de la compétitivité avec le mot-clé « innovation ».
Les auteurs s’attaquent alors à cette notion d’innovation, qui apparaît au sein du vocable « recherche et innovation » comme l’alpha et oméga des relations entre science et société. L’occasion de rappeler la stratégie de Lisbonne lancée en 2000 par le Conseil européen, pour faire de l’Europe la première « économie de la connaissance » du monde. De fait, l’innovation se retrouve placée au cœur de l’économie, et la recherche devient un maillon essentiel de la prospérité économique. Toute la recherche publique s’oriente alors dans le but de produire des innovations, la recherche fondamentale étant même réduite à des champs disciplinaires susceptibles de produire de l’innovation à très court terme, et la R&D privée reportée sur le public avec des dispositifs comme le Crédit d’impôt recherche (CIR). L’imprévisibilité et le hasard heureux (sérendipité), qui seuls peuvent déboucher sur du vraiment neuf, n’existent plus. Le champ libre est laissé à une économie de la promesse, basée sur la promesse de bienfaits sans précédent pour l’humanité, tellement spéculative qu’elle contribue à générer des bulles technologiques qui finissent forcément par éclater
(p. 34). Alors qu’une innovation doit rencontrer un imaginaire social pour trouver son marché, les politiques d’innovation actuelles échouent à la fois à engager le consommateur pour définir des valeurs d’usage définies collectivement, et à trouver dans le citoyen un soutien acceptant les risques engendrés par les innovations.
C’est alors que les auteurs abordent la question des publics de la science (au sens de John Dewey) : comment peuvent-ils investir les questions posées par la science et ses effets qui les concernent ?
(p. 50). Sur le plan de l’éducation, la culture technique reste une « culture du pauvre » distinguant les filières professionnelles et techniques des filières générales, alors même que toute culture générale devrait inclure une réflexion sur la technique. Les actions de culture scientifique, technique et industrielle (CSTI) vont dans ce sens mais elles restent notoirement insuffisantes
(en quantité ou en qualité, les auteurs ne le précisent pas). Sur le plan de l’intervention citoyenne, le débat sur les choix scientifiques et techniques reste confisqué ou exclut les profanes, laissant dans la course les seules associations dont les membres, professionnellement ou socialement, sont très proches des producteurs de science et de technologies
(p. 54). L’expert est valorisé voire sacralisé, quand bien même la spécialisation des formations scientifique et la césure entre sciences de la nature et sciences humaines revient à faire des scientifiques des êtres quasiment incultes dans tous les domaines dont ils ne sont pas spécialistes, des ingénieurs formatés, (…) ou des décideurs sans formation scientifique
(p. 55).
Après cet état des lieux de la recherche scientifique, les auteurs reviennent sur les mobilisations et les luttes des quinze dernières années. Qui se souvient que l’European Research Council, destiné à soutenir la recherche fondamentale, fut un cadeau de l’Union européenne aux chercheurs en colère (p. 40) ? Que l’Unesco publia en 1998 une Déclaration mondiale sur l’enseignement supérieur pour le XXIe siècle, si humaniste et opposée à l’éthique néo-libérale (p. 106) ? Que le syndicat de l’enseignement supérieur SNESUP a participé en 1998 à la création de l’association Attac, puis en 2000-2011au lancement du Forum social mondial (avec le syndicat de la recherche SNCS) ? Les luttes décrites par les auteurs, dont les mouvements Sauvons la recherche (2004) et Sauvons l’université (2009), sont mues par l’idée que la recherche est un bien commun universel, qui ne peut être défendu que dans le cadre d’un service publics
(p. 61). Malheureusement, elles n’ont pas toujours été couronnées de succès : les recommandations des états généraux de la recherche conclus à Grenoble en octobre 2004 ont été perverties par les équipes ministérielles successives en charge de la recherche (…) au bénéfice de la stratégie de Lisbonne
(p. 64) et si les mesures portant atteinte à l’indépendance statutaire des enseignants-chercheurs ont été retirées, aucun des autres aspects de la loi Pécresse n’a été modifié. Quant aux Assises de l’enseignement supérieur et de la recherche organisées à l’automne 2012, des promesses ont été faites à la communauté scientifique dont il ne reste à peu près rien
(p. 65).
Enfin, les auteurs énoncent un ensemble de propositions qui sont autant de pistes pour redéfinir l’entreprise scientifique. Admettant avec humilité que leur réflexion les a conduits à faire face à de nombreuses contradictions, tensions, difficultés
(p. 16), et à défaut de pouvoir en donner des résolutions définitives, ils proposent des leviers pour avancer, dans un esprit de pluralisme et de diversité. Ainsi, ils recommandent d’abord de recontextualiser la recherche, les chercheurs se devant d’être impartiaux mais pas d’être neutres : à eux de tenir compte de tout le contexte d’actions, de valeurs, de représentations, d’expériences
(p. 86) dans lesquels s’insère le phénomène qu’ils étudient — une notion empruntée au philosophe Hugh Lacey, mais aussi à la philosophie féministe des sciences. Ils décrivent également la recherche participative, tout en pointant ses limites. Ils proposent de redonner du sens à la notion de science comme bien commun (l’une des co-auteurs du livre, Danièle Bourcier, est responsable scientifique des licences Creative Commons pour la France). Ils défendent l’importance d’un débat citoyen pour définir les priorités de recherche (et pas seulement trancher les choix techniques), qu’ils ne veulent pas confier aux seuls scientifiques. Ils invitent les travailleurs scientifiques et les citoyens à se rencontrer pour inventer une démocratie scientifique, et convoquent les militants des mouvements sociaux et des partis de gauche pour qu’ils s’emparent des questions scientifiques au lieu de les déléguer aux seuls scientifiques — et, ce faisant, aux détenteurs du capital
(p. 103).
Le cri central de l’ouvrage est un appel à la vigilance citoyenne pour résister contre les risques et les dérives de la technoscience, et pour le développement de recherches “libres”
(p. 49). Mais tout en se revendiquant de gauche, les auteurs n’hésitent pas à égratigner le gouvernement actuel et sa ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, Geneviève Fioraso, quand elle soutient l’Opération d’intérêt national (OIN) du plateau de Saclay lancée par la droite ou qu’elle poursuit avec la loi Fioraso la même vision du rôle de la recherche que dans la loi Pécresse.
Ce travail synthétique donne des armes pour comprendre la politique contemporaine de la recherche. Bien qu’émaillé d’exemples concrets, ses formules définitives manquent parfois d’illustrations concrètes. Par exemple, quand les auteurs regrettent la réduction des champs disciplinaires à ceux qui paraissent susceptibles de produire de l’innovation à très court terme
(p. 31) : comment expliquer alors que l’Inra s’éloigne de la recherche appliquée à l’agriculture pour aller vers une recherche d’apparence plus fondamentale en génomique, biologie des systèmes etc. ? Ceci s’explique par le mouvement concomitant de mondialisation de la recherche qui nécessité de publier dans des revues à fort facteur d’impact.
Les auteurs concluent leur propos en regrettant que la science [soit] détournée au seul service de la rentabilité d’un capital concentré aux mains d’une oligarchie financière de plus en plus réduite et puissante
(p. 121). Ce langage connoté politiquement ne doit pas éloigner le lecteur curieux des transformations actuelles de la recherche, qui trouvera dans cet ouvrage un vade-mecum utile à la réflexion et l’action.


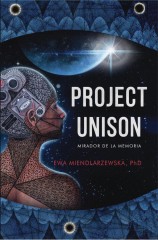


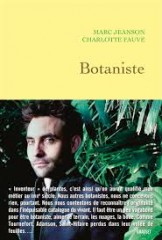
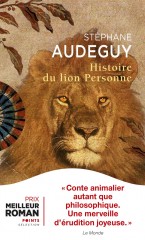



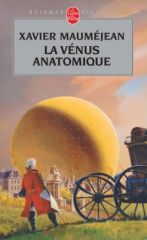
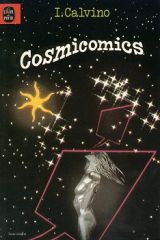
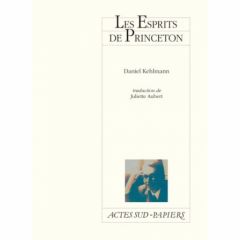






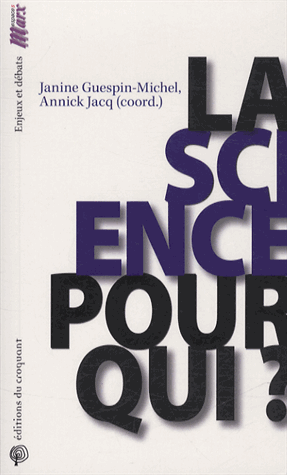
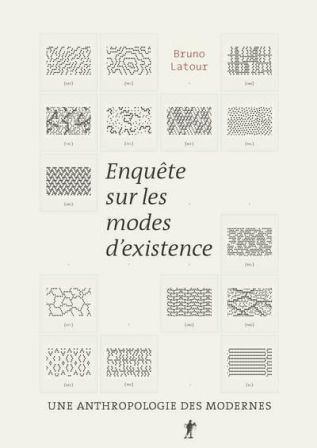

Derniers commentaires