30
déc.
2010
Dans le dernier numéro de sa feuille de choux (décembre 2010), la British Science Association consacre un intéressant article au travail du GIEC. Vous vous souvenez qu'en mars dernier, le Secrétaire Général des Nations Unies et le Président du GIEC ont chargé le Conseil Inter-Académique (qui rassemble l’ensemble de l’expertise et de l’expérience d’Académies nationales des sciences de toutes les régions du monde
) d'étudier le GIEC et de recommander des façons de renforcer les processus et les procédures qui serviront à la préparation de ses futures évaluations
. Dans ce rapport publié en août, il est dit notamment que toute action basée sur des preuves scientifiques implique forcément une estimation du risque et une procédure de gestion du risque
. Pourtant, ce point n'est pas plus développé.
Dans son article, donc, Jay Gulledge (directeur du Science and Impacts Program au Pew Center on Global Climate Change), écologue de formation et spécialiste des échanges gazeux entre le sol et l'atmosphère, regrette que le GIEC ait tant contribué à montrer depuis deux décennies que le climat est en train de changer à cause de l'action de l'homme, tout en laissant les décideurs dépourvus d'outils pratiques pour faire face à l'immense question de politiques publiques qui s'ensuit. Depuis son premier rapport publié en 1990, le GIEC semble considérer que les politiques publiques découleraient naturellement de la résolution des incertitudes scientifiques. S'il y a une "valeur" propre au GIEC et aux climatologues, comme se le demandaient ICE, Benoît Urgelli et Gayané Adourian et dans une discussion sur le Pris(m)e de tête, c'est probablement celle-là.
Or, pour réduire l'incertitude on doit poser de nouvelles questions, et cela augmente bien souvent l'incertitude ! De plus, la structuration du GIEC en groupes de travail a conduit à séparer les sciences de la nature des sciences sociales, au détriment de l'interdisciplinarité voulue pour une bonne estimation du risque. Ainsi, les économistes ont longtemps estimé les coûts du changement climatique en utilisant les températures moyennes que leurs fournissaient les modèles du climat futur. Or ce sont bien souvent les températures et événements climatiques extrêmes qui détruisent les cultures ou bloquent un pays ! Les moyennes sont peu utiles à l'estimation du risque, et privent les décideurs d'outils pratiques pour gérer le risque et l'adaptation au climat de demain.
Certes, les choses commencent à changer lentement et dans son rapport de 2007, le GIEC reconnaissait que répondre au changement climatique implique un processus itératif de gestion du risque qui inclut à la fois l'adaptation et l'atténuation, et qui prend en compte les dégâts du changement climatique, les cobénéfices, la durabilité, l'équité et les comportements face au risque
. Mais en pratique l'interdisciplinarité n'est pas organisée et reste sous-financée. Je signale d'ailleurs aux lecteurs intéressés que le dernier numéro de la revue Natures Sciences Sociétés est consacré à l'adaptation aux changements climatiques...

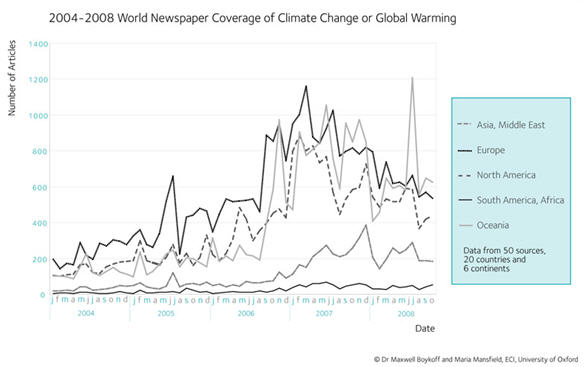
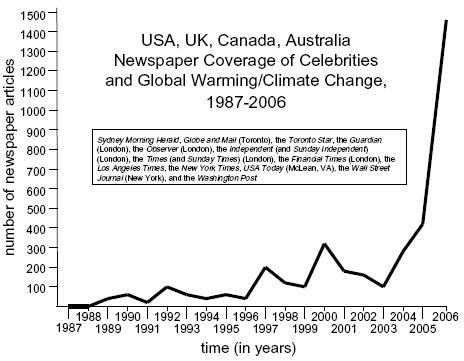

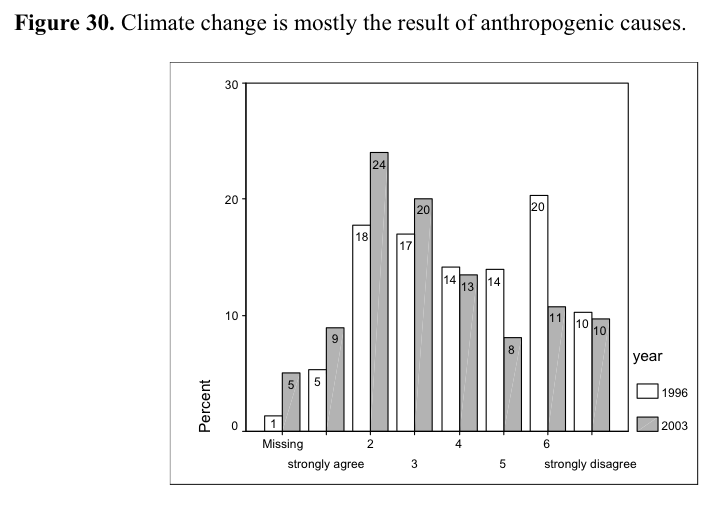


Derniers commentaires