7
juil.
2014
Dans son livre intitulé Les Jeux de l’esprit (1971), Boulle imagine ce que Saint-Simon avait proposé un siècle auparavant dans ses Lettres d’un citoyen de Genève (1802) : un monde gouverné par un groupe de savants, le “conseil de Newton”, et une humanité vouée à la production et à la science. Chez Boulle, le conseil de Newton a seulement été renommé le Gouvernement scientifique mondial (GSM).
Oh que cela plairait à tous les scientistes d’aujourd’hui ! En effet, écrit Pierre Boulle,
les savants étaient arrivés à considérer qu’ils formaient de par le monde la véritable internationale, la seule valable, celle de la connaissance et de l’intelligence. La science était pour eux à la fois l’âme du monde et la seule puissance en mesure de réaliser les grands destins de celui-ci, après l’avoir arraché aux préoccupations triviales et infantiles de politiciens ignares et bavards. Alors, au cours de nombreux entretiens amicaux, presque fraternels, était peu à peu apparue la vision d’un avenir triomphant, d’une planète unie, enfin gouvernée par le savoir et la sagesse.
Car une seule chose animait la communauté des savants :
l’idéal connaissance était le pôle commun à tous les esprits scientifiques de cette époque. Pour les physiciens, il s’agissait d’une véritable religion ; pour les biologistes, d’une sorte d’éthique, un acte gratuit dont il sentaient confusément la nécessité impérieuse pour échapper au désespoir du néant. Les uns et les autres estimaient que cette connaissance totale ne serait atteinte que par les efforts conjugués de l’humanité toute entière.
Or les savants sont partageurs. Comment pourraient-ils garder pour eux un tel idéal de connaissance et de sagesse ? Les voici donc lancés dans un programme de prise de conscience scientifique du monde
. Car ils ne veulent plus refaire les mêmes erreurs et tiennent à éviter l’écueil dangereux, autrefois sarcastiquement signalé par les romanciers d’anticipation : le partage de l’humanité en deux classes, les savants et les autres, ceux-ci condamnés aux travaux grossiers et utilitaires, ceux-là enfermés dans une tour d’ivoire, bien trop exiguë pour permettre l’épanouissement total de l’esprit
.
C’est là que Boulle fait une description visionnaire, qui rejoint tellement le rêve de certains vulgarisateurs et popularisateurs des sciences :
Un immense réseau de culture scientifique enserrait le monde. Un peu partout, des établissements grandioses s’étaient élevés, avec des amphithéâtres assez nombreux et assez vastes pour que, par un roulement savamment organisé, la population entière des villes et des campagnes pût y prendre place en une journée, avec des bibliothèques contenant en milliers d’exemplaires tout ce que l’homme devait apprendre pour s’élever l’esprit, depuis les rudiments des sciences jusqu’aux théories les plus modernes et les plus complexes. Ces centres étaient également pourvus d’un nombre considérable de salles d’étude, avec microfilms, appareils de projection, télévision, permettant à chacun de se familiariser avec les aspects infinis de l’Univers. Dans des laboratoires équipés des instruments les plus modernes, tout étudiant pouvait faire des expériences personnelles sur les atomes, provoquer lui-même des désintégrations, suivre le tourbillon magique des particules à travers bêtatrons et cyclotrons, mesurer avec des appareils d’une délicatesse extrême les durées de quelques milliardièmes de seconde séparant la naissance et la mort de certains mésons.
Tout va bien dans le meilleur des mondes ? Non, parce que Boulle est un adepte du “renversement ironique”, comme le nota si bien le critique Jacques Goimard. Très souvent, il s’est attelé à faire ressortir les paradoxes de l’esprit humain et le côté dérisoire de nos aspirations utopiques. Car rapidement, le GSM ne peut que constater les échecs essuyés en matière d’instruction mondiale
:
Chaque famille voulait avoir sa maison particulière avec piscine. Cette soif de bien-être, ce désir du monde de s’approprier les acquisitions de la science et de la technique sans en comprendre l’esprit et sans avoir participé à l’effort intellectuel de découverte, ne se limitaient pas aux habitations. (…) Des savants, des cerveaux précieux devaient interrompre ou ralentir leurs travaux de recherche fondamentale, dirigés vers le vrai progrès, pour se mettre au service du monde et satisfaire ses besoins immodérés de confort, de luxe et de raffinement matériels.
Eh oui ! La chute est d’autant plus rude que le rêve était grand : rien à faire, l’Homme restera l’être paradoxal qu’il est, autant capable de pensées absolues que de désirs de confort matériel. Ce que Roy Lewis (à qui l’on doit le célèbre Pourquoi j’ai mangé mon père) décrit également dans son uchronie mordante La Véritable Histoire du dernier roi socialiste (1990). Sa prémisse, c’est celle d’une civilisation “socialiste” qui a mis la science et les savants sous la protection de l’Inpatco (International Patent Convention), allant au bout de quatre grands courants de pensée en vogue en 1848 :
les craintes prémonitoires des romantiques selon lesquelles la science et la technologie allaient séparer l’homme de la nature et de Dieu
- le luddisme, ce mouvement ouvrier qui démolit les métiers à tisser pour sauvegarder le gagne-pain des drapiers et tisserands
- le socialisme, conçu en réaction
contre le capitalisme et le système industriel
- la théorie darwinienne de l’évolution, qui fit entrevoir
l’accession des machines à la faculté de penser et, par conséquent, la réduction de la fonction humaine au service des machines et au développement de leurs capacités
.
Dans cette uchronie, une version alternative de l’Histoire telle qu’elle aurait pu être si les révolutions de 1848 avait tourné différemment, l’Inpatco n’est rien d’autre qu’un “trust universel” auquel est confié la propriété, au nom de l’humanité, de toutes les nouvelles inventions, à charge de ne les mettre en circulation que lorsqu’elles produiraient des emplois et des améliorations des conditions d’existence sans entraîner désastres ni chômage, ni destruction de la nature
. Pas question par exemple d’introduire l’électricité, qui mettrait à mal les travailleurs du gaz. La bicyclette, elle, fut mise en circulation avec un grand succès, alors que une suggestion de doter les villes de vélos-taxis efficaces ou de voitures à pédalier a été repoussée avec violence par les cochers de fiacre
.
Résultat :
Vers le milieu des années 1860, les gouvernements et les populations laïques avaient perdu le contact avec les travaux et les objectifs des savants et des techniciens. Vers 1880, ils n’étaient plus au courant de ce qui se passait dans les réserves [laboratoires de l’Inpatco]. Le XXe siècle était déjà bien entamé qu’on sous-estimait encore largement les progrès réalisés par l’Inpatco dans les domaines scientifique et technique. Les réserves furent fermées au public. Les publications spécialisées de l’Inpatco étaient protégées et interdites de vente dans les librairies coopératives. De toutes façons, le citoyen socialiste profane n’aurait pu les comprendre.
À défaut, les peuples d’Europe et d’Amérique s’ennuient et se droguent à l’opium, distribué légalement : à eux les paysages exotiques et érotiques, bien qu’illusoires et destructeurs de cellules grises, de l’empire du pavot…
Alors que chez Pierre Boulle le gouvernement scientifique produisait une humanité vautrée dans le confort, chez Roy Lewis ce luxe est inaccessible et seule la griserie de la drogue permet d’échapper à un morne quotidien. Deux extrêmes donc, mais un point commun à vingt ans d’écart : ces deux contes servent surtout à illustrer le côté dérisoire de nos aspirations modernes, et l’impossibilité pour notre société de devenir aussi savante que ses savants.
Ce point de vue est intéressant, et bien traité dans les deux cas. Mais ce qui m’étonne, c’est que ces auteurs interrogent nullement les motivations des savants, lesquels ne font que ce que les gouvernements leur demande. Je fais l’hypothèse qu’aujourd’hui, avec l’essor de la sociologie des sciences, la littérature s’intéressera de plus en plus à ce qui meut les savants collectivement et individuellement. C’est le cas de quelques (grands) romans que j’ai lu récemment et que je vous recommande : Intuition d’Allegra Goodman (2006), thriller psychologique sur une suspicion de fraude dans un laboratoire de biologie ; Des éclairs de Jean Echenoz (2010), biographie romancé de Nikola Tesla ; et Solaire de Ian McEwan (2010), roman cynique sur un prix Nobel de physique en prise avec sa vie et sa carrière.
N.B. : La partie sur Les Jeux de l’esprit est tirée de mon article “Retour sur le colloque Pari d’avenir : pourquoi changer les pratiques de la culture scientifique ?” (août 2008).

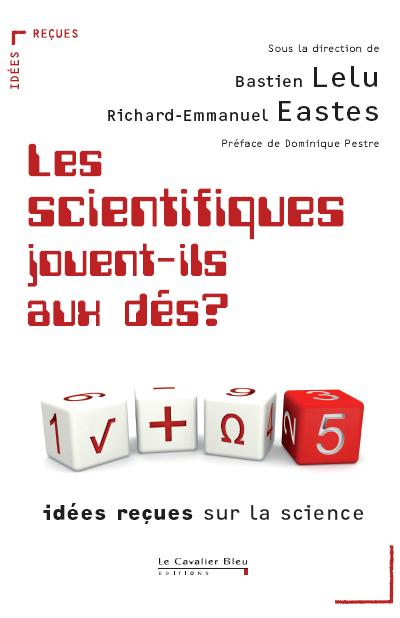


Derniers commentaires