22
nov.
2007
Vous vous souvenez de l'impact de l'effet Mozart dans la société américaine et de sa diffusion par "mutation", voici une nouvelle étude de psychologie sociale qui fait les grands titres (et ça devrait continuer, selon Fabrice qui m'a filé le tuyau). Ce travail (français !) à paraître dans le Journal of Experimental Social Psychology teste l’effet "inconscient" des stéréotypes sur le comportement, en l'occurrence le stéréotype de la blonde. Où il s'avère que nous faisons un moins bon score au Trivial Pursuit après avoir examiné le visage de reines de beauté blondes que d'hommes bruns. Mais le plus important ici n'est pas tant l'effet d'amorce d'un stéréotype, relativement connu, que l'observation que cet effet ne se manifeste dans le même sens que le stéréotype (ici : les réponses aux questions sont moins bonnes parce que les blondes sont considérées comme plus stupides) uniquement quand on a mis le participant dans un état accru d'interdépendance aux autres ; s'il se construit comme indépendant des autres, il réussit mieux le test après avoir vu le portrait de femmes blondes !
Un article de sept pages seulement, un résultat simple à expliquer, la figure centrale de la blonde sur laquelle on peut disserter à l'infini : voilà du pain béni pour les journalistes ! Non seulement parce qu'ils ont un résultat scientifique bien emballé, mais parce qu'ils peuvent moduler le rôle de la blonde : la femme fatale qui va jusqu'à nous faire oublier notre propre QI (les hommes, les yeux dans les yeux d’une blonde, éprouvent des problèmes au niveau de leurs capacités intellectuelles et voient leur QI baisser
) ou l'idiote façon Paris Hilton (même si some blondes are of course highly intelligent
, sic). Quitte à oublier que les femmes étaient tout autant affectées par le stéréotype dans l'étude, qu'un test de connaissance n'est pas un test de QI ou qu'on peut se mettre à la place de quelqu'un et reproduire son stéréotype sans l'avoir en face de soi… La plupart des articles ou dépêches ayant ensuite repris l'information du Sunday Times, on ne trouve rien de bien différent chez FOXNews ou United Press.
Et si la recherche scientifique n'avait pas pour but d'établir des vérités pré-mâchées mais de construire du social, en disant : "voici ce que des chercheurs en blouse blanche ont découvert dans leur laboratoire, à vous d'en faire quelque chose" ?
C'est vrai en général (comme l'ont montré les sociologues connexionnistes comme Latour) mais c'est flagrant dans la couverture médiatique des découvertes scientifiques. Il ne s'agit pas tant de se soumettre à de l'indiscutable que de s'emparer de chiffres et d'observations objectivées pour les retraduire (par exemple, les rapprocher de l'expérience quotidienne ou les rendre moins perturbants). Mais cela ne signifie pas que les chercheurs sont impuissants pour autant : selon la manière dont leur article est rédigé et la revue où il est publié (comme dans l'exemple du gène de l'homosexualité), selon le témoignage qu'ils vont apporter aux journalistes qui téléphonent en masse, ils orientent la manière dont leur fait brut est transformé en fait social. Dans cet exemple, le stéréotype de la blonde était presque trop "vendeur"[1] et les journalistes, privés de la possibilité de faire leur travail (trouver un angle, creuser le sujet), ont dû s'embarquer trop loin et dériver.
En tous cas, des articles de psychologie sociale qui donnent (presque) lieu à des observations de psychologie sociale, c'est une ironie qui ne peut que m'amuser ! Même si je n'irai pas jusqu'à avancer que c'est un coup monté par les chercheurs aux dépens des journalistes, pour mieux les étudier…
Notes
[1] Selon le premier auteur, Clémentine Bry, ce stéréotype a été choisi pour rigoler parce que plus léger que d'autres stéréotypes utilisés dans la littérature.

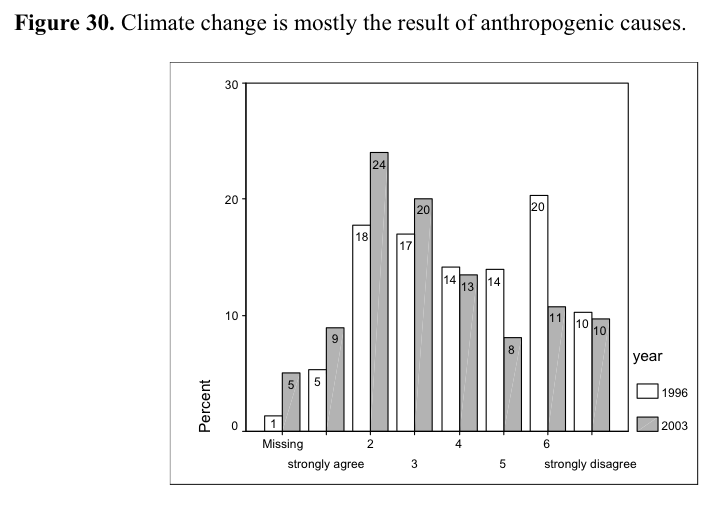



Derniers commentaires